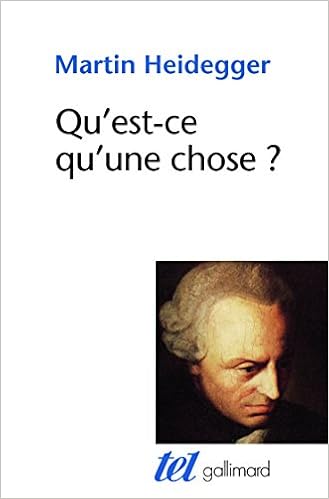C'est le physicien Carlo Rovelli qui a attiré mon attention sur Anaximandre. Il lui a consacré un livre : Anaximandre de Milet ou la naissance de la pensée scientifique, (Dunod, 2009). Il y souligne le saut conceptuel accompli par Anaximandre qui semble être le premier à s'être représenté la terre comme un caillou flottant dans le vide. Il ne se trompait que sur sa forme : il la voyait comme une colonne de pierre plate aux deux extrémités. Rovelli est aussi l'auteur d'un bestseller mondial : Sept brèves leçons de physique (Odile Jacob, 2015).
En mars 2018, j'ai entendu Rovelli à la radio, à propos de son dernier livre, L'Ordre du temps -formule empruntée à Anaximandre (le 01 03 18, puis 17 03 18, les deux sur France Culture). Il m'a semblé qu'il était peut-être temps de prendre dans ma bibliothèque mon vieux volume Folio Essais consacré aux Ecoles présocratiques. Le chapitre sur Anaximandre, né à la fin du VII°siècle, ce qui en fait l'un des plus anciens présocratiques, se trouve au début, juste après Thalès, et tient en 17 pages. Comme pour Héraclite, il ne reste rien d'Anaximandre que des fragments cités par divers auteurs, une vingtaine, dont Diogène Laërce, Aristote, Cicéron, Pline ou Plutarque. Et aussi Hippolyte, auteur d'un ouvrage orthodoxement intitulé Réfutation de toutes les hérésies.
Anaximandre, notait Hippolyte, est donc l'élève de Thalès. Anaximandre, fils de Praxiadès, de Milet. Il disait que le principe des choses existantes est une certaine nature de l'Illimité (Apeiron) dont naissent les cieux et le monde qui se trouve en eux. Cette nature est éternelle et ne vieillit pas (agero).
Ne vieillit pas : autrement dit est sans cesse neuve. Marcel Conche a traduit agero par invieillissable (Anaximandre, Fragments et témoignages, PUF, 1991). Une traduction allemande propose : Die Apeiron ist ohne Alter, sans vieillesse. Dans la version de la Physique d'Aristote, on trouve la même formule avec un vocabulaire différent : Cela revient à faire de l'Illimité le divin, car il est immortel et impérissable.
Cette propriété qu'il prête à l'apeiron me semble être aussi une propriété de la matière. En juin 2007, le physicien Serge Haroche présentait avec une belle concision ses travaux sur les photons, en deux pages qui ne sont pas sans évoquer la formule d'Anaximandre (Vie et mort d'un photon : une autre manière de voir, Lettre du Collège de France, n°20) :
Nous avons pu récemment observer des centaines de fois un photon piégé dans une boîte. Après un intervalle de temps perceptible qui peut atteindre une demi-seconde, le grain de lumière finit par disparaître, de façon imprévisible et soudaine. [...] La longévité de nos photons n'a, en soi, rien d'exceptionnel. En liberté dans le vide, un photon est éternel. La lumière qui nous provient des confins de l'Univers après avoir voyagé des milliards d'années en témoigne.
Peut-on extrapoler et dire de toutes les particules, tant qu'elles n'interagissent pas, ou plutôt tant qu'elles ne sont pas transformées à la suite d'une interaction, qu'elles sont éternelles, donc sans cesse neuves ?
C'est le premier paragraphe de ces deux pages qui avait d'abord attiré mon attention : Le photon, grain élémentaire de lumière, particule omniprésente et véhicule de l'information n'est en général observable que lorsqu'il disparaît. Ainsi la rétine absorbe la lumière et la transforme en un courant électrique qui stimule le nerf optique. Un phénomène analogue se produit sur la surface sensible des photodétecteurs usuels. L'information portée par les photons est détruite au fur et à mesure qu'elle est enregistrée. On peut voir un objet macroscopique aussi souvent qu'on le veut, mais ce sont à chaque fois de nouveaux photons qui véhiculent son image vers l'oeil.
La lumière du jour provient du soleil, celle de la nuit de l'électricité, ou de la lune et des étoiles -soleil, étoiles, éclairage électrique : tous ne produisent-ils pas continûment des photons absolument nouveaux ? Dans la journée notre rétine absorbe ''de nouveaux photons'' à chaque instant de la vision -nouveaux au sens d'un afflux continu d'autres photons, mais aussi physiquement nouveaux, puisqu'ils nous viennent tout droit du soleil et que nul oeil avant le nôtre ne les a captés. Tout droit : c'est du moins ce qu'on pourrait croire. Mais Jean-Marc Lévy-Leblond, dans De la Matière, (Seuil, 2006), explique que le photon que l'oeil absorbe n'est pas le photon solaire qui arrive dans l'atmosphère : il y a passage de relais d'atome à atome, par absorption du photon et émission d'un autre photon. La question que j'aimerais poser à un physicien : quand un atome de l'atmosphère, ou le filament d'une ampoule ou une flamme émettent un photon, -est-ce un photon déjà existant qui est recyclé, ou est-ce un photon qu'on peut tenir pour absolument nouveau ? Tout rayonnement n'est-il pas nécessairement un rayonnement physiquement neuf ?
Dans ce même livre de Jean-Marc Lévy-Leblond se trouve un autre élément (que j'ai déjà évoqué) en faveur de cette idée, celui de l'identité des particules : De fait, une propriété essentielle des objets quantiques d'un genre donné (les électrons, les photons, etc.) est leur identité absolue : tous les électrons sont absolument identiques, on ne peut pas, par principe, les discerner. Et il cite un auteur américain, Peter Pesic : Les objets quantiques manquent totalement de singularité. [...] Les électrons sont radicalement égaux. L'individualité d'un électron est son espèce, et rien de plus ; il n'est qu'une occurrence d'''électronité'', et rien de plus. (Seeing Double, MIT Press, 2002).
Identité absolue : j'en conclus qu'il n'y a donc ni jeunes ni vieilles particules, qu'une particule persiste telle quelle à travers le temps sans altération physique, dure sans vieillir, jusqu'à ce qu'une interaction la transforme. Autrement dit, qu'une particule est sans cesse neuve, que la matière est sans cesse neuve, que la nature, qui est une masse de particules, est sans cesse physiquement neuve.
En mars 2018, j'ai entendu Rovelli à la radio, à propos de son dernier livre, L'Ordre du temps -formule empruntée à Anaximandre (le 01 03 18, puis 17 03 18, les deux sur France Culture). Il m'a semblé qu'il était peut-être temps de prendre dans ma bibliothèque mon vieux volume Folio Essais consacré aux Ecoles présocratiques. Le chapitre sur Anaximandre, né à la fin du VII°siècle, ce qui en fait l'un des plus anciens présocratiques, se trouve au début, juste après Thalès, et tient en 17 pages. Comme pour Héraclite, il ne reste rien d'Anaximandre que des fragments cités par divers auteurs, une vingtaine, dont Diogène Laërce, Aristote, Cicéron, Pline ou Plutarque. Et aussi Hippolyte, auteur d'un ouvrage orthodoxement intitulé Réfutation de toutes les hérésies.
Anaximandre, notait Hippolyte, est donc l'élève de Thalès. Anaximandre, fils de Praxiadès, de Milet. Il disait que le principe des choses existantes est une certaine nature de l'Illimité (Apeiron) dont naissent les cieux et le monde qui se trouve en eux. Cette nature est éternelle et ne vieillit pas (agero).
Ne vieillit pas : autrement dit est sans cesse neuve. Marcel Conche a traduit agero par invieillissable (Anaximandre, Fragments et témoignages, PUF, 1991). Une traduction allemande propose : Die Apeiron ist ohne Alter, sans vieillesse. Dans la version de la Physique d'Aristote, on trouve la même formule avec un vocabulaire différent : Cela revient à faire de l'Illimité le divin, car il est immortel et impérissable.
Cette propriété qu'il prête à l'apeiron me semble être aussi une propriété de la matière. En juin 2007, le physicien Serge Haroche présentait avec une belle concision ses travaux sur les photons, en deux pages qui ne sont pas sans évoquer la formule d'Anaximandre (Vie et mort d'un photon : une autre manière de voir, Lettre du Collège de France, n°20) :
Nous avons pu récemment observer des centaines de fois un photon piégé dans une boîte. Après un intervalle de temps perceptible qui peut atteindre une demi-seconde, le grain de lumière finit par disparaître, de façon imprévisible et soudaine. [...] La longévité de nos photons n'a, en soi, rien d'exceptionnel. En liberté dans le vide, un photon est éternel. La lumière qui nous provient des confins de l'Univers après avoir voyagé des milliards d'années en témoigne.
Peut-on extrapoler et dire de toutes les particules, tant qu'elles n'interagissent pas, ou plutôt tant qu'elles ne sont pas transformées à la suite d'une interaction, qu'elles sont éternelles, donc sans cesse neuves ?
C'est le premier paragraphe de ces deux pages qui avait d'abord attiré mon attention : Le photon, grain élémentaire de lumière, particule omniprésente et véhicule de l'information n'est en général observable que lorsqu'il disparaît. Ainsi la rétine absorbe la lumière et la transforme en un courant électrique qui stimule le nerf optique. Un phénomène analogue se produit sur la surface sensible des photodétecteurs usuels. L'information portée par les photons est détruite au fur et à mesure qu'elle est enregistrée. On peut voir un objet macroscopique aussi souvent qu'on le veut, mais ce sont à chaque fois de nouveaux photons qui véhiculent son image vers l'oeil.
La lumière du jour provient du soleil, celle de la nuit de l'électricité, ou de la lune et des étoiles -soleil, étoiles, éclairage électrique : tous ne produisent-ils pas continûment des photons absolument nouveaux ? Dans la journée notre rétine absorbe ''de nouveaux photons'' à chaque instant de la vision -nouveaux au sens d'un afflux continu d'autres photons, mais aussi physiquement nouveaux, puisqu'ils nous viennent tout droit du soleil et que nul oeil avant le nôtre ne les a captés. Tout droit : c'est du moins ce qu'on pourrait croire. Mais Jean-Marc Lévy-Leblond, dans De la Matière, (Seuil, 2006), explique que le photon que l'oeil absorbe n'est pas le photon solaire qui arrive dans l'atmosphère : il y a passage de relais d'atome à atome, par absorption du photon et émission d'un autre photon. La question que j'aimerais poser à un physicien : quand un atome de l'atmosphère, ou le filament d'une ampoule ou une flamme émettent un photon, -est-ce un photon déjà existant qui est recyclé, ou est-ce un photon qu'on peut tenir pour absolument nouveau ? Tout rayonnement n'est-il pas nécessairement un rayonnement physiquement neuf ?
Dans ce même livre de Jean-Marc Lévy-Leblond se trouve un autre élément (que j'ai déjà évoqué) en faveur de cette idée, celui de l'identité des particules : De fait, une propriété essentielle des objets quantiques d'un genre donné (les électrons, les photons, etc.) est leur identité absolue : tous les électrons sont absolument identiques, on ne peut pas, par principe, les discerner. Et il cite un auteur américain, Peter Pesic : Les objets quantiques manquent totalement de singularité. [...] Les électrons sont radicalement égaux. L'individualité d'un électron est son espèce, et rien de plus ; il n'est qu'une occurrence d'''électronité'', et rien de plus. (Seeing Double, MIT Press, 2002).
Identité absolue : j'en conclus qu'il n'y a donc ni jeunes ni vieilles particules, qu'une particule persiste telle quelle à travers le temps sans altération physique, dure sans vieillir, jusqu'à ce qu'une interaction la transforme. Autrement dit, qu'une particule est sans cesse neuve, que la matière est sans cesse neuve, que la nature, qui est une masse de particules, est sans cesse physiquement neuve.